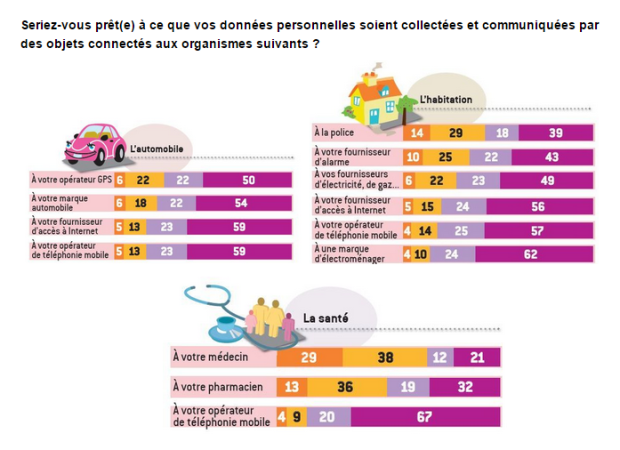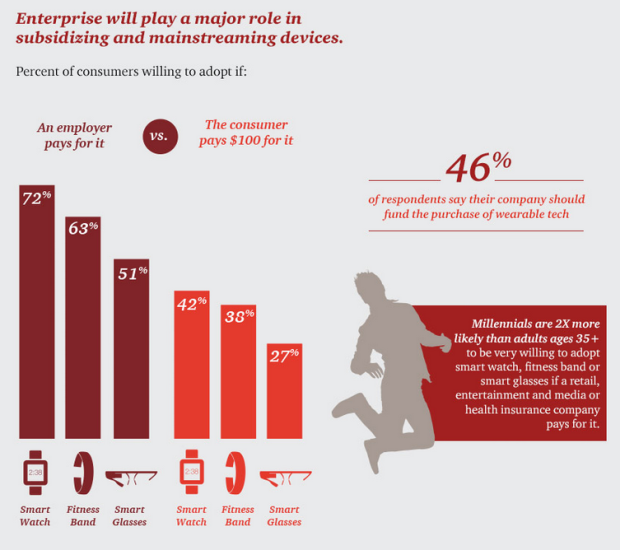Mardi prochain, 17 novembre, aura lieu la deuxième édition de l’Innovation Ecosystem Agora (IEA), au Pôle Léonard de Vinci de La Défense (Paris). Cette édition sera dédiée aux laboratoires d’innovation d’entreprises, les fameux Innovation Labs. J’ai rencontré récemment Eric Seulliet, l’organisateur de l’événement, qui a bien voulu m’accorder une interview sur cet événement.
Bonjour Eric. Peux-tu te présenter rapidement : ton parcours et tes activités actuelles ?
Je travaille dans l’innovation depuis une quinzaine d’années, après avoir démarré dans le marketing. Il y a 10 ans, j’ai créé un think tank, La Fabrique du futur, qui travaille sur tout ce qui est co-innovation, co-design, innovation collaborative, etc. C’est en vogue aujourd’hui, mais quand on a commencé, on était dans l’évangélisation. L’idée clé, c’est : comment co-créer ensemble ? En 2008, La Fabrique du Futur a été labellisée living lab européen. On fait partie du réseau ENoLL (European Network of Living Labs). En 2012, on a créé France Living Labs, le réseau français des livings labs, dont je suis vice-président. Il y a 2 ans, j’ai lancé le DIL (Discovery Innovation Lab), qui a vocation à être un do-tank (en complément de l’aspect think tank de La Fabrique du Futur), pour accompagner les entreprises, les grands groupes ou les startups dans leurs démarches d’innovation, depuis la phase de veille, d’idéation, puis de prototypage et d’expérimentation, jusqu’à la mise sur le marché (1).
En 2014, tu as créé l’Innovation Ecosystem Agora (IEA). Peux-tu nous décrire cet événement ?
J’ai fait le constat qu’il y avait beaucoup de dispositifs d’innovation et d’entrepreneuriat qui émergeaient partout : living labs, fab labs, incubateurs, accélérateurs, techshops, etc. Chaque semaine, il y en avait un nouveau. Le problème, c’est que ces labs se créaient souvent en silos, en s’ignorant, voire en concurrence plutôt qu’en coopération. Or, un lab isolé n’a pas grand sens en soi. Ces dispositifs doivent s’interconnecter, être reliés en écosystèmes. Et être multifacettes, polymorphes ! De là est née l’Innovation Ecosystem Agora : une journée de conférences et d’échanges pour que tous les acteurs de l’innovation se rencontrent, fassent connaissance et échangent entre eux.
Le 17 novembre prochain, aura lieu l’édition 2015. Peux-tu nous la présenter ?
Alors que l’édition 2014 portait sur tous les écosystèmes d’innovation, cette édition 2015 se focalise sur les labs d’innovation. On a constaté en effet que l’année 2014-2015 avait vu la création de multiples labs d’innovation dans les grands groupes. On a donc décidé d’en faire le sujet de l’édition 2015. Par ailleurs, on a initié une étude sur le sujet. D’autres organismes l’ont fait également. On les a donc invités à présenter les résultats de leurs études. La journée commencera par une table ronde qui va poser la problématique globale des labs d’innovation. On va dresser un panorama des labs d’innovation en France (et également dans le monde, grâce à une étude réalisée par Capgemini sur ce sujet). Il y aura ensuite des ateliers pour creuser des thèmes particuliers : outils et méthodes, les lieux des labs, les talents et compétences nécessaires, etc. Enfin, on terminera par une plénière qui restituera les résultats des ateliers. Il y aura aussi une session de « Labs speed meetings » pour que les acteurs des labs et leurs partenaires se rencontrent.
A l’occasion de cet événement, le DIL va présenter les résultats d’une étude que vous menez depuis de longs mois sur les nouvelles formes d’innovation ouverte (dont les labs d’innovation font partie). Peux-tu nous présenter les principaux enseignements de cette étude ?
Je dirai que l’open innovation commence à s’organiser dans les entreprises. Alors qu’auparavant ces démarches donnaient lieu à des initiatives très foisonnantes et assez dispersées, actuellement, l’open innovation d’une certaine manière se professionnalise. Les labs sont justement l’illustration d’une open innovation davantage organisée. Les lieux sont conçus spécifiquement pour favoriser la collaboration et la créativité, ils accueillent des équipements spécifiques, on y expérimente des méthodes et des outils avancés, le management dans ces labs est lui-même innovant, on y est attentif à la création de valeur que ces dispositifs génèrent…
Selon toi, comment évoluent les laboratoires d’innovation d’entreprise dans le contexte de la transformation digitale de ces dernières ? Jouent-ils un rôle de plus en plus important dans ce contexte ?
Oui, c’est certain. D’une part, les labs contribuent à cette transformation digitale car ils s’appuient beaucoup sur le digital, utilisent des plateformes virtuelles pour aider à la co-création, à la co-conception… Un domaine en fort développement sera sans conteste celui de la réalité virtuelle et de la 3D. Ces technologies qui peuvent servir à faire du prototypage, de la simulation de situations et comportements seront sans nul doute au cœur d’une nouvelle génération de labs d’innovation et fablabs, plus avancés et plus connectés. De par leur effet d’exemplarité et d’entrainement, ces labs high tech contribueront bien évidemment à la transformation digitale des composantes plus traditionnelles des organisations.
J’ai l’impression que les labs d’innovation d’entreprise peuvent prendre de nombreuses configurations. Pourrais-tu dresser une typologie des différents types de labs d’innovation ? ou nous indiquer des tendances ?
Dans le cadre de l’étude, on a fait un mapping des labs. Derrière le mot « lab » on peut mettre beaucoup de choses : un fablab interne, un incubateur, une plateforme de co-design, un plateau de créativité… On peut aussi les classer suivant les objectifs qu’ils poursuivent : tantôt servir les objectifs du core business en optimisant l’innovation dans l’entreprise, tantôt explorer de nouveaux domaines et faire de l’innovation de rupture. Il y a aussi des labs davantage tournés vers l’interne, pour par exemple acculturer les employés à l’innovation et développer leur côté entrepreneurial et créatif.
En quoi différent-ils des cellules de R&D ?
La R&D est en amont. Tandis que labs sont plus tournés vers l’innovation et ses débouchés concrets sur les marchés. Ils agissent aussi plus dans un esprit d’open innovation au lieu d’être fermés dans l’entreprise. L’idée clé, c’est qu’ils font de l’innovation tournée vers les usages et les usagers et pas de la recherche technologique pure.
J’imagine que tu dois bien connaître un certain nombre d’entre eux. Quels sont ceux qui t’impressionnent le plus ? Aurais-tu des exemples de labs d’innovation dont tu trouves la démarche et les résultats particulièrement intéressants ?
De manière assez subjective, j’aime bien la démarche du i-Lab d’Air Liquide. Il a un côté polymorphe (fablab, relation start-up, etc.) et me paraît assez mature. En ce sens, il est assez exemplaire.
Il y a aussi des initiatives très intéressantes chez Leroy-Merlin avec leur Techshop, chez Dassault Systèmes avec le 3D User Experience Lab ou encore Alive, le nouvel environnement dédié à l’innovation de Décathlon.
Les labs d’innovation sont-ils réservés aux grandes entreprises ? Peut-on en créer et en animer dans une PME ou une ETI ?
Pour les ETI, c’est évident ! Thuasne est un bon exemple d’ETI qui vient de créer un lab. Ils devraient d’ailleurs être présents le 17 nov. à l’IEA. Concernant les PME, elles n’ont ni les mêmes besoins ni les mêmes moyens que les ETI ou les grands groupes. Une PME est par exemple plus en contact avec le terrain, dont elle se nourrit pour innover. Elle peut aussi utiliser d’autres solutions, tels que des labs externalisés, par exemple des fablabs indépendants ou des techshops comme Usine io. Il y a aussi des sociétés comme Axandus, qui mettent leurs capacités de prototypage industriel à la disposition des PME et des startups. Il y a aussi des pôles de compétitivité qui créent des labs. Par exemple, le pôle de compétitivité des industries du commerce à Lille a créé le SiLab (Shopping Innovation Lab), pour inventer le commerce du futur. Il y a aussi des universités qui en créent. Des collectivités territoriales également. Bref, tout un écosystème sur lequel les PME peuvent s’appuyer.
Quels conseils donnerais-tu à une entreprise qui voudrait créer un lab d’innovation ?
Le plus important c’est de savoir pourquoi on le crée. Il faut avoir des idées claires sur la stratégie et ne pas simplement céder à une tendance de mode. Manifestement certains labs se sont créés avant tout pour des raisons de communication. Il faut aussi réfléchir aux moyens à mobiliser pour les créer, car il y a une vraie exigence de moyens. On peut cependant mutualiser ces moyens : il faut alors réfléchir avec qui et comment.
Un lab d’innovation doit-il être isolé du reste de l’entreprise ou impliquer tout le monde ?
En fait, les 2 à la fois ! D’une part, il faut une équipe porteuse du lab, avec un leader très impliqué. Le profil de ces managers de labs est très important. Ce sont des profils souvent atypiques de gens qui pratiquent la transversalité. Et qui sont créatifs. D’autre part, il ne faut pas que le lab soit un électron totalement libre. Il doit être autonome mais pas complètement indépendant, sinon il ne profitera pas au reste de l’organisation. Il faut donc créer des passerelles avec le reste des métiers. Les labs peuvent aussi expérimenter de nouvelles façons de manager dans les entreprises, par exemple les démarches agiles dans un esprit startup. Donc, ça peut aussi impacter positivement le reste de l’organisation et contribuer à l’innovation managériale. C’est un objectif à poursuivre.
Comment vois-tu l’évolution de l’IEA dans les années à venir ?
Au-delà d’être un événement ponctuel, il est prévu que l’IEA devienne un outil permanent au service des labs d’innovation. Une plateforme de ressources et d’échanges, d’information, de bonnes pratiques, etc. J’y travaille !
——-
(1) Eric Seulliet est également co-auteur du livre Fabriquer le futur 2, L’imaginaire au service de l’innovation.